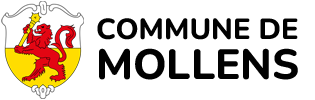Histoire des Mitcha-Bou Mollens
Morlens en 1139, Mollens dès 1228, on a trouvé en 1846 entre Mollens et Ballens, à la Tuillerie, des vestiges de constructions en briques datant de l'époque romaine ainsi que diverses médailles de bronze. Au moyen âge, Mollens dépendait du Couvent de Romainmôtier, une branche des seigneurs de Mont le Grand avait l'avouerie (justice). De graves dissentiments survinrent de bonne heure entre ces deux autorités; en 1281 un arrangement fut conclu par lequel Girard et Nicolas, seigneurs de Mont, cédèrent moyennement 14 livres leurs prétentions sur les possessions de Romainmôtier à Mollens.
En 1314, un échange intervint entre Agnès de Villars, dame d'Aubonne et Etienne de Mont qui céda la seigneurie et l'avouerie de Mollens contre la dîme du Cauderay près de Bavois.
Vers la fin du 13ème siècle, on bâtissait la ville de Morges, elle attira plusieurs citoyens de Mollens qui auraient voulu garder à la foi leurs champs dans leur village et les privilèges des bourgeois de Morges ; le Prieur réclama auprès de Louis de Savoie, à la suite de quoi une transaction intervint qui décida que les hommes de Mollens seraient libres de garder leurs champs en acquittant les redevances envers le couvent, ou de demeurer à Morges en renonçant à leurs terres.
Il a existé une famille noble de Mollens dont le premier cité est Girard, seigneur de Mont vers l'an 1300 et l'un des derniers fut Jean de Mollens, châtelain de Cossonay en 1395. La famille s'éteignit dans le courant du 15ème siècle. Pendant l'époque de la domination bernoise, le village avait une cour de justice composée du châtelain et de 10 justiciers. Le village faisait partie du bailliage de Morges. Le château de Mollens a appartenu à la famille Mayor pendant le 19ème siècle et est actuellement la propriété de la famille Voruz.
Au début de l'époque bernoise, le premier seigneur de Mollens a été Jean Steiger, avoyer de Berne en 1542, lequel donna en échange à L.L.E.E. certains droits à Arzier et Begnins contre les dîmes de blé de Mollens, évaluées à 40 Muids.
En 1674, Jeanne Steiger, petite fille du précédent, apporte la seigneurie à son époux, Gabriel de Weiss, haut commandant du Pays de Vaud. A la fin du 18ème siècle, la seigneurie de Wattewille, dont un des ressortissants était gouverneur d'Aigle, fit construire le château de Mollens en 1791.
Le 5 avril 1798 un incendie détruisit 48 maisons et 20 pièces de bétail furent perdues. Les archives qui étaient gardées dans l'église, furent détruites et les cloches fondirent.
Les armoiries de Mollens, telles que nous les connaissons actuellement, furent celles des seigneurs. Elles ont été adoptées en 1922.
La population de Mollens était de 553 habitants en 1853, elle est de 294 aujourd'hui, après un creux de 216 habitants en 1980.
U. Henchoz 1953
Développement de l'agglomération
Rattaché au prieuré de Romainmôtier (jusqu'au 13e s. ) puis aux seigneurs d'Aubonne (13e- début 16e s.), les terres et le village de Mollens n'accèdent à l'autonomie seigneuriale qu'à la conquête bernoise. Ceci au profit de la famille Steiger, puis Weiss, enfin, dès 18e s., de Watteville qui en modernise le château. En avril 1798 un incendie détruit 48 maisons et l'église, soit la pratique totalité du village. Le plan de Malherbes dressé un demi-siècle plus tard (1852) indique qu'à cette époque non seulement le village était reconstruit sur les traces originaires, mais qu'il s'était largement complété. Le milieu du 19é s. est l'époque d'un maxima démographique à Mollens, et l'on compte quelques 600 habitants. La population ne cesse de décroître fortement depuis lors pour atteindre 220 habitants vers les années 1990. La population en augmentation est de plus de 282 habitants à ce jour. L'édition de la carte Siegfried (1895-98), située en pleine phase de décroissance rend donc compte d'un tissu maximal et déjà immobile depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, la population a retrouvé un niveau deux fois inférieur à celui de la fin de l'ancien régime bernois, et l'état du tissu est toujours celui de 1850. La seule modification importante survenue dans le site entre 1850 et nos jours est la correction (entre 1852 et 1894) du tracé de la route de transit. Le tracé primitif passait par Forchy, longeait comme aujourd'hui le bas du village jusqu'au château, obliquait ensuite vers l'ouest pour contourner le noyau seigneurial et sortir à flan de coteau en longeant un alignement de fermes. Plusieurs groupements ruraux en périphérie de site trahissent cet ancien endroit.
La structure du tissu est un exemple très pur de la disposition en "arête de poisson", soit d'un tissu organisé le long d'une rue rectiligne orientée pleine pente et dont les édifices, par séquences contiguës forment des groupes barlongs orientés petit côté sur rue. Le tissu de Mollens présente en outre la particularité d'être organisé le long de deux rues centrales parallèles déterminant entre elles un dégagement intermédiaire consacré aujourd'hui comme sous l'ancien Régime, à des cultures potagères et fruitières. Le bâti est essentiellement agricole, l'élément fondamental est la ferme tripartite comprenant maison grange et écurie disposées transversalement. Ces éléments s'associent entre eux par des pignons et constituent des arêtes rattachées à la voirie centrale par un petit côté, soit un pignon. Ce pignon bordier reste généralement borgne ou percé irrégulièrement. Il ne devient façade qu'en cas d'exposition exceptionnelle au soleil et de localisation du logement à la rue. Dans la règle, les fermes s'ouvrent par les gouttereaux sur de longues cours agricoles disposées entre deux arêtes et communes à tous les propriétaires du rang amont (`` indivises``). Côté opposé à la rue, les cours débouchent directement dans les environnements d'où leurs dénominations "places et sorties".
L'accroissement du tissu se fait par adjonction de nouvelles arêtes à la rue, soit par la prolongation de celles qui préexistent. Les plans de Bermont-Jaquier (1744) et Monod (1782-1784) permettent de suivre cet accroissement à Mollens durant la seconde moitié du 18e s. En 1744, toutes les arêtes existent mais ne comprennent généralement, notamment le long de la rue méridionale, qu'une seule tripartite. Deux générations plus tard (1784), aucune nouvelle implantation n'est apparue. Par contre toutes les arêtes existantes ont vu leurs plans carrés devenir barlongs par adjonction successives de un à trois triplets maison - grange - écurie. En moyenne le nombre de triplets est doublé. La juxtaposition des éléments tripartites se fait soit en série, soit symétriquement par les écuries, ou les logements.
Mollens présente également un caractère secondaire des villages rues en arête de poisson qui est la localisation dé centralisée en pied de rue des équipements communautaires (église, auberge ) ou seigneuriaux (château). L'église et le château constituent un groupement très dense localisé dans la portion inférieure de la rue nord.
Le château, rénové par Nicolas Alexandre de Watteville en 1791, présente une rare orientation cour sur jardin et vue, due à la reprise des anciennes structures. La cour prise entre un corps de logis principal et deux ailes en retour d'équerre est fermée par une grille monumentale tenue par six piliers en pierre de taille surmontés d'urnes. Elle donne sur un quinconce de tilleuls et un jardin potager, aujourd'hui coupé du château par le passage de la nouvelle voie de transit (2eme moitié du 19e s.).
Outre l'exemplarité de la structure, Mollens possède une substance pratiquement intacte. Malgré l'incendie de 1798, la majorité des fermes est antérieure dans leur structure au début de 18ème s. et se présente en séquences parfaitement conservées. La chute démographique, la survivance de l'activité agricole ont conservé au tissu non apprêté et abrité des transformations pittoresques et faussement vernaculaires qu'amène généralement le développement des fonctions résidentielles et touristiques.
L'alpage du Pré de Mollens
Sur les hauteurs de Mollens, un chalet d'alpage à visiter
Site internet